AAR Français - Troisième session
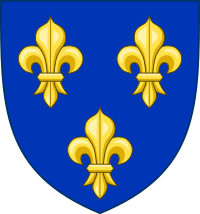
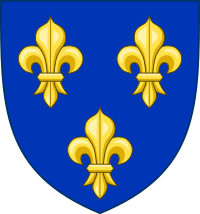
- 1487 - 1507 : Fin du règne du Roi Louis XII dit le Juste (4-4-4)
Au sortir de la guerre, toute l'Europe de l'Ouest est exsangue : plus aucun État ne dispose d'hommes en âge de combattre et certains connaissent même des difficultés financières. L'Autriche notamment a été particulièrement touchée et est grandement fragilisée : profitant de cette faiblesse, les Ottomans envahissent la Hongrie à la fin de l'année 1487.
Louis XII se réjouit de cette invasion qui lui permet de redresser la situation de son Royaume ; afin de sauver les apparences et de ne pas être accusé de complaisance envers les infidèles, il forge une alliance avec la Papauté.
Lors du précédent conflit, le Royaume de France a eu recours à de nombreux emprunts pour financer les compagnies de mercenaires ; souhaitant parer à toute éventualité future, le Roi Louis organise le marché de la dette souveraine, permettant ainsi au Royaume de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt moindres. Rapidement, l'économie française est remise sur pied et les campagnes se repeuplent.
Au fil des guerres victorieuses, les troupes françaises ont aussi développé une fougue au combat sans aucune pareille en Europe : confiantes dans leur capacité, elles partent à la guerre la fleur à l'arquebuse.
En 1490, alors que l'Autriche sort tout juste de sa guerre contre les Turcs, la France envahit la Lorraine : le Duché, bien que peuplé de Bourguignons, est soumis à l'Autriche du fait de son appartenance au Saint Empire ; cette situation n'est pas tolérée par Louis XII qui entend achever l'unification de son Royaume. N'étant pas en mesure de s'engager dans un nouveau conflit meurtrier, l'Archiduc accède rapidement aux revendications justes et légitimes du Royaume de France, qui fait du Duché de Lorraine son nouveau vassal.
Souhaitant conserver les faveurs de l'aristocratie, le Souverain renforce le servage en 1494 : en liant les paysans à la terre, il permet également au Royaume d'accéder plus facilement à un réservoir d'hommes prêt à prendre les armes ; pour s'assurer que ces derniers demeurent à leur place, la censure est renforcée et la production d'écrits strictement réglementée.
Cette même année voit aussi l'éclatement d'un nouveau conflit franco-bourguignon. Depuis l'échec de coalition, la situation géopolitique a fortement changé, ainsi peu de pays souhaitent et sont en mesure de venir en aide à leur ancien allié : l'Autriche en tête ; mais également l'Angleterre qui préfère vainement tenter de facturer chacune de ses interventions. La Bourgogne se retrouve donc de nouveau seule et Louis XII est en mesure de réaliser son double objectif : il s'agit non seulement de donner une leçon au Duc de Bourgogne ; mais aussi de libérer le peuple wallon, opprimé par ses voisins Flamands et Néerlandais qui tentent d'imposer leur horrible langue. En 1496, la Wallonie est conquise et le Hainaut, Liège et le Luxembourg peuvent enfin goûter au plaisir de pouvoir parler français librement.
Spoiler:
Fort de ses hauts faits, Louis XII renforce la centralisation du Royaume. Des individus brillants accourent à la cour du Roi qui s'implique dans tous les domaines : la loi sur la Milice est passée en 1495 et confère au Souverain le commandement de la Milice d'État.
Mais tandis que des puissances se font, d'autres se défont : la même année, le Portugal est attaqué par le Sultanat du Maroc et les cupides Anglais et Hansois. Cette alliance impie est aussitôt montrée du doigt par l'ensemble des puissances catholiques ; mais malgré tous ses efforts et son influence sur la Papauté, Louis XII ne parvient pas à faire excommunier les hérétiques : il s'agit de la première déconvenue concernant le Saint-Siège et l'Église romaine en général, il y en aura d'autres.
L'année suivante, les Ottomans se lancent à nouveau dans une guerre sainte contre la Hongrie : tandis que l'Autriche honore son alliance, le Royaume de France se tient calme ; il s'agit de ne pas tracer aux Turcs une route jusqu'à Vienne.
Mais alors que le premier conflit s'était conclu sur un statu quo, la deuxième guerre turco-autrichienne s'achève sur une victoire des infidèles, qui s'emparent de Raguse. Souhaitant le maintien d'un équilibre des puissances en Europe centrale, Louis XII préfère se refuser à toute guerre contre le Saint Empire.
Son âge le rattrape lentement : afin de léguer à son fils un Royaume fort et stable, il choisit de consacrer ses dernière années à l'administration de ce dernier. Une nouvelle fois il flatte la noblesse, lui accordant des privilèges au sein des armées françaises. Grâce au soutien des États Généraux, les taxes sont augmentées sans pour autant que cela ne crée d'agitation parmi la population.
Ces réformes sont facilitées par la montée d'un sentiment national naissant et quelques concessions accordées aux parlements.
En 1504, le Duché de Provence est intégré au Royaume et l'économie est progressivement modernisée : malgré son désir centralisateur, Louis XII limite les interventions de l'État dans le domaine économique et cette bouffée d'air libre provoque une hausse de la productivité.
Avec l'intégration de la Provence, la France dispose d'une fenêtre ouverte sur la Méditerranée et l'Italie du Nord : ne voyant pas d'un bon oeil l'expansion particulièrement agressive et opportuniste de la Toscane, le Roi choisit de se porter garant de l'indépendance du Duché de Milan. Faisant fi de cette garantie, le téméraire prince toscan tente d'envahir la Lombardie : il se voit contraint de signer la paix l'année suivante.
Les ambitions toscanes sont claires et ces derniers sont prêts à tout (personne n'a oublié que quelques années plus tôt, ils n'ont pas hésité à se donner aux infidèles turcs). La nécessité pour la France de contrôler la Savoie et les Alpes, véritables remparts face aux menaces extérieures, devient donc évidente pour le Roi Louis : alors que les troupes toscanes font route pour Florence, l'armée française envahit la Savoie.
L'Empereur hésite un temps sur l'attitude à adopter face à cette nouvelle agression du Saint-Empire ; malheureusement pour lui, l'année suivante les Ottomans déclarent de nouveau la guerre à la Hongrie et les troupes autrichiennes partent combattre à l'Est pour la troisième fois. Comble de malchance, le Protestantisme fait son apparition la même année en Brandebourg : les temps s'annoncent durs pour l'Empire.
Spoiler:
Bien que fortuite, la nouvelle invasion ottomane inquiète Louis XII : avec son impulsion, le Pape appelle à une nouvelle croisade contre la Sublime Porte. Mais sous le poids de l'âge et des tracas, il trépasse le 26 Octobre 1507.
- 1507 - 1512 : Règne du Roi Charles VIII dit le Protestant (6-0-3)
Spoiler:
Charles VIII s'attelle avant tout d'achever la guerre débutée par son père : en 1508, il s'empare définitivement de la Savoie et de Nice.
Peu versé dans les arts diplomatiques, il finit cependant par perdre l'influence française acquise au fil des ans sur le Saint-Père ; c'est la goutte de trop pour lui qui a assisté toute sa vie durant à de nombreux écarts commis par les Catholiques : en 1509, le Protestantisme est déclaré religion d'État en France et les monastères ainsi que leurs biens sont saisis.
Grâce à la Milice et aux pouvoirs acquis par les différents Roi qui se sont succédés, la situation reste stable et bientôt une grande partie de la population adopte la nouvelle foi ; le Roi nomme également des inspecteurs ecclésiastiques censés surveiller la population. A la fin de l'année, les pasteurs sont autorisés à collecter des taxes parmi la population.
Même la noblesse accepte aisément ce changement, et le rayonnement de celle-ci même en dehors des frontières du Royaume permet de promouvoir le Protestantisme dans toute l'Europe.
Spoiler:
En 1510, tandis que le Duché de Lorraine est intégré au Royaume, Charles VIII focalise son attention sur le reste de l'Europe. Alors que la Savoie contrôle encore des zones-clefs des Alpes, il faut avant tout contenir l'avancée ottomane. Bientôt, le premier Royaume protestant d'Europe fait ce que les Catholiques auraient dû faire depuis bien longtemps : la France garantit l'indépendance de la Hongrie.
A suivre...














 ), est mystérieusement mort deux années auparavant ; son jeune frère n'est pas en âge de régner et la régence du Royaume est confiée à la Reine Anne de Dreux.
), est mystérieusement mort deux années auparavant ; son jeune frère n'est pas en âge de régner et la régence du Royaume est confiée à la Reine Anne de Dreux.

 je suis aussi dangereux et je ne suis pas qu'un bête soutien de l'empire ottoman , non mais....
je suis aussi dangereux et je ne suis pas qu'un bête soutien de l'empire ottoman , non mais....


 .
.

Commentaire